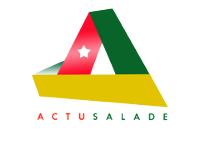Depuis 2015, la mutilation génitale féminine (MGF) est interdite en Gambie et la loi prévoit des peines allant jusqu’à la perpétuité en cas de décès. Cependant, malgré ce cadre légal strict, la pratique reste largement répandue. D’après l’UNICEF, près de 73 % des femmes et filles gambiennes âgées de 15 à 49 ans y ont été soumises à cette pratique.
C’est dans ce contexte que la mort d’un nourisson âgée d’à peine un mois a bouleversé le pays. L’excision a eu lieu dans le district de Kombo Nord. L’enfant a subi une grave hémorragie mais transféré d’urgence à l’hôpital, elle n’a pas survécu. Ce drame a suscité une vague d’indignation et ravivé le débat autour de cet rituel.
Lire aussi : Engouement des Togolais au défi culinaire de Laurence : réel soutien ou… Free Food ?
Ainsi, pour les défenseurs des droits humains, cet événement constitue un signal d’alarme. L’avocate Santana Simiyu affirme que la culture ne doit en aucun cas justifier la violence. De son côté, l’activiste Fatou Baldeh, elle-même survivante, qualifie l’excision de « violence pure » et insiste sur l’urgence de protéger les enfants.
Pourtant, malgré l’interdiction et la gravité des conséquences, certaines voix réclament la dépénalisation. En 2024, un projet de loi en ce sens a été débattu au Parlement. Bien qu’il ait été rejeté, le sujet reste très controversé, notamment parce que des leaders religieux continuent de défendre l’excision en la présentant comme un rite traditionnel.

Face à cette réalité, les associations locales et internationales estiment qu’il ne suffit pas d’avoir une loi. Il faut l’appliquer efficacement, former les forces de l’ordre et sensibiliser les communautés afin de rompre le poids des traditions et des pressions sociales.
La mort de ce nourrisson rappelle avec force que l’excision n’est pas seulement un débat culturel mais bel et bien une question de vie ou de mort.
Sandrine TCHAMIE